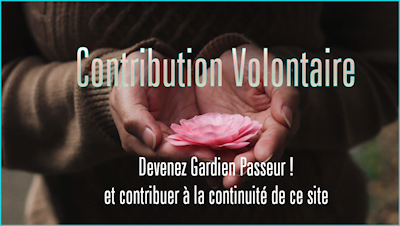Imaginez… Vous courez un marathon et dépassez le concurrent en deuxième position. Quelle place occupez-vous désormais ? La plupart des gens répondent rapidement : me voilà en tête ! Mais, si l’on réfléchit un peu plus, l’évidence s’impose : vous venez de prendre la place du deuxième, non pas du premier !
Problème : aujourd’hui, 60 % de la population mondiale utilise les réseaux sociaux1, s’exposant à un flot continu d’informations de toutes provenances. Pas simple de jauger la véracité de chacune ! La détection des fake news (ou « infox 2»), ces fausses nouvelles volontairement fabriquées et diffusées pour piéger le public et influencer les opinions, constitue donc un enjeu social, mais aussi politique : manipulation d’élections, influence sur les campagnes de vaccination, etc.
Estimer l’exactitude des nouvelles
Or tous les individus ne sont pas armés face aux fake news, notamment les adolescents, dont le développement cérébral ne s’achève qu’entre 20 et 25 ans. Des chercheurs du Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (LaPsyDÉ) 3 ont mené une étude 4 pour combler la lacune subsistant dans la littérature à l’égard du discernement de la vérité chez les adolescents.
D’abord, 432 enfants âgés de 11 à 14 ans ont estimé l’exactitude de 56 nouvelles (28 vraies et 28 fausses). Chacune était présentée sous la forme d’un titre associé à une accroche et à une image pour ressembler à une publication de réseau social (également appelée « post »).
De plus, les sources initiales avaient été effacées et remplacées par des sources considérées comme fiables pour la moitié des nouvelles (des vraies et des fausses) et par des sources non fiables pour l’autre moitié. Il s’agissait ainsi d’annuler l’influence potentielle de la source d’origine sur la réponse des participants. Lesquels n’avaient accès à aucun moyen de vérifier la véracité des publications.

L’enjeu n’était donc pas de savoir si un post était vrai ou faux, mais d’évaluer sa véracité perçue, en estimant son exactitude sur une échelle de 1 à 4. Premier résultat, rassurant : plus les collégiens sont âgés, mieux ils repèrent les fausses informations parmi les 56 soumises, et ce, quel que soit leur genre (le milieu social n’a pas été exploré).
Résister aux biais cognitifs
Ensuite, afin d’identifier les processus cognitifs impliqués, les chercheurs ont complété le premier test par un test de réflexion cognitive. Avec des questions de ce type : « Une balle et une batte coûtent 110 €, et la batte coûte 100 € de plus que la balle. Combien coûte la balle ? » Première réponse qui vient à l’esprit, d’instinct : 10 €.
Mais le cerveau se trompe. La bonne réponse est : 5 € pour la balle, afin que le total se monte à 110 € (la batte coûtant 105 €, soit bien 100 € de plus que la balle).
Le cerveau n’aboutit à la bonne réponse que s’il résiste à ses biais pour s’engager dans un raisonnement analytique, plus chronophage et énergivore.
Aux mêmes questions piégeuses, environ la moitié d’un échantillon de 132 adultes de 18 à 34 ans a répondu correctement, contre moins d’un quart des 11-14 ans. Les notes au test de réflexion cognitive augmentent avec l’âge des participants, ce qui est cohérent avec le développement de la pensée logique et la littérature scientifique.
La comparaison des résultats des adolescents aux deux tests révèle que ceux qui ont le mieux identifié les fake news (premier test) sont aussi ceux qui ont présenté une meilleure capacité de raisonnement (second test). Le développement du discernement de la vérité est donc lié au développement du raisonnement.
Les deux systèmes de la pensée
Raisonner implique d’activer son « système 2 », selon la théorie des processus duaux du psychologue et économiste Daniel Kahneman 5. Car deux systèmes de pensée coexistent dans nos cerveaux, détaille Marine Lemaire, doctorante en psychologie au LaPsyDÉ et première autrice de l’article : « Le premier système est automatique, intuitif, peu coûteux en énergie cognitive et, s’il nous permet de répondre rapidement aux situations quotidiennes, il peut se tromper dans certaines situations pièges. Le deuxième système, délibératif, s’avère beaucoup plus lent et coûteux en énergie. Il prend le temps de la réflexion avant de répondre. »
Raisonner signifie résister aux automatismes de pensée du système 1 au profit de la réflexion du système 2 : « Nos résultats révèlent que, chez l’adolescent, le développement de la capacité à identifier les fake news est en partie lié au développement de la capacité de raisonnement, c’est-à-dire d’utilisation du système 2. »
L’effet de vérité illusoire
Autre partie de l’étude : présenter aux adolescents la moitié des nouvelles avant le début du test, en leur faisant croire à un autre exercice. Puis ces actualités leur sont à nouveau soumises, mélangées aux autres, lors du test.
« Les informations familières, vues deux fois, sont perçues comme plus vraies que celles nouvellement présentées aux participants », indique Marine Lemaire. Il s’agit de ce que l’on appelle l’« effet de vérité illusoire » : « Plus on voit une information, plus on a tendance à croire qu’elle est vraie. C’est un biais très robuste, détecté dès l’âge de 5 ans.6 »
L’étude montre que ni l’âge ni la capacité de raisonnement n’influent sur l’effet de répétition – retrouvé également chez l’adulte. Nous sommes tous piégés de la même façon par les informations familières que nous voyons. « Plus une information est familière, observe la doctorante, plus elle est facile à traiter du point de vue cognitif, et le cerveau interprète cette aisance comme un indice de véracité. »
À 11 ans, pas de distinction
Dernier résultat marquant de l’étude : la distinction entre fake news et informations vraies par les jeunes de 11 ans. « En moyenne, nous n’avons pas trouvé de différence significative du point de vue statistique », relève Marine Lemaire. Autrement dit, à 11 ans, on n’est pas encore capable de différencier une vraie nouvelle d’une infox.
Or, en France, en 2024, 63 % des jeunes de 7 à 10 ans interrogés déclaraient utiliser au moins un réseau social.7 Et si l’âge minimum légal d’inscription sur les réseaux sociaux est de 13 ans avec accord parental et de 15 ans sans, nombre d’adolescents enfreignent la règle. Car, à ce jour, la vérification de l’âge est purement déclarative. La bataille de la vérification de l’âge à l’inscription sur les réseaux se jouera sans doute à l’échelle européenne, où le règlement sur les services numériques impose déjà des contraintes aux grandes plateformes.
Mais il y a une bonne nouvelle, explique Grégoire Borst, directeur du LaPsyDÉ et coauteur de l’article : « Il est possible d’expliquer aux enfants comment fonctionnent les algorithmes avant même qu’ils soient sur un réseau social. »
Manque de ressources
Il faudrait donc élargir l’éducation aux médias et à l’information (EMI), qui enseigne notamment des principes journalistiques tels que l’évaluation de la fiabilité des sources et leur croisement.
« À l’heure actuelle, l’EMI comprend très peu de ressources sur la cognition et les biais inhérents à un cerveau humain qui tente de déterminer la véracité d’une information, alerte le chercheur. Il faudrait, par exemple, détailler le biais de confirmation, qui nous fait privilégier les contenus confortant nos opinions. »

Pour l’instant, cette sensibilisation n’occupe pas de place spécifique dans les programmes. Mais l’étude menée sur le discernement de la vérité chez les adolescents sert la psychologie interventionnelle, en lui fournissant des clés pour développer des ressources pédagogiques.
« Un processus sur lequel nous pouvons agir »
« Nous avons montré que la capacité de raisonnement joue un rôle pour identifier les fake news, pointe Marine Lemaire, donc c’est un processus sur lequel nous pourrons agir ensuite pour aider les jeunes à distinguer le vrai du faux.8 »
Sur le site Lea.fr(link is external), des enseignants volontaires ont collaboré avec les scientifiques pour créer des interventions, afin d’expliquer les systèmes de pensée aux jeunes et de les sensibiliser aux biais cognitifs9. Ces interventions sont ensuite dispensées par les professeurs dans les classes. Au total, plus de 100 classes ont été mobilisées, de la sixième à la troisième, soit plus de 3000 adolescents.
Les premiers résultats indiquent que cette sensibilisation aide davantage à discerner la vérité que les séquences d’EMI classiques. Mais ses effets semblent ne pas durer, « peut-être parce que deux séances de 45 minutes ne suffisent pas », avance Grégoire Borst. L’analyse des données recueillies est en cours et précisera ces premiers résultats.
Cultiver « le doute raisonnable »
« La vraie difficulté que nous rencontrons, ajoute Grégoire Borst, est de développer la pensée critique des adolescents, tout en évitant qu’ils se mettent à douter de toutes les informations. Sinon, ils risquent de se réfugier sur des sites diffusant uniquement des informations avec lesquelles ils sont déjà d’accord, voire d’adhérer à des théories complotistes. »
Il conseille plutôt de « cultiver le doute cartésien, c’est-à-dire le doute raisonnable » et « d’aller creuser si quelque chose nous interpelle ». De se faire confiance, donc. Mais aussi de laisser le temps à son système 2 de s’activer et d’accepter d’attendre avant de prendre une décision.
Marine Lemaire le rappelle : il ne faut pas stigmatiser les adolescents, qui détectent de mieux en mieux les fake news en grandissant. D’autant qu’ils ne les repartagent pas forcément – au contraire, par exemple, des personnes âgées. Une étude10 a révélé que, lors de la campagne présidentielle de 2016 aux États-Unis, les plus de 65 ans partageaient en moyenne 7 fois plus de fake news sur Facebook que les 18-29 ans ! ♦
Notes
- 1.Rapport « Digital 2023 », publié par We Are Social et Meltwater : https://tinyurl.com/yrxm83au(link is external)
- 2.Infox : contraction d’« information » et d’« intoxication ».
- 3.Unité CNRS/Université Paris Cité.
- 4.Voir Scientific reports : https://doi.org/10.1038/s41598-025-90427-z(link is external)
- 5.Théorie développée dans l’ouvrage « Thinking, Fast and Slow » (2011), publié en France sous le titre « Système 1/Système 2 : des deux vitesses de la pensée » (Flammarion, 2012).
- 6.Voir Psychological science : https://doi.org/10.1177/0956797620939534(link is external)
- 7.Étude « Parents, enfants et numérique 2024 », Observatoire de la parentalité et de l’éducation numérique : https://tinyurl.com/2s4c325a5(link is external)
- 8.Ce point est l’objet d’une thèse de Maria Ghazi au LaPsyDÉ.
- 9.Voir https://tinyurl.com/resister-fakenews(link is external)
- 10.https://doi.org/10.1126/sciadv.aau4586(link is external)
Source:https://lejournal.cnrs.fr/articles/fake-news-oui-les-adolescents-peuvent-se-defendre
Traduit et partagé par les Chroniques d'Arcturius
– Au service de la Nouvelle Terre –