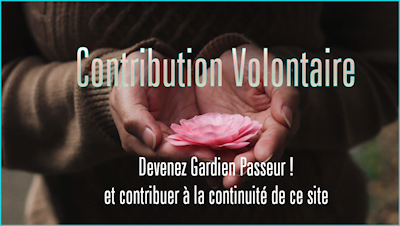Quand les antibiotiques modernes viennent à manquer, les remèdes de Mère Nature prennent le relais. Bien avant les pharmacies.Les gens ont survécu grâce aux plantes médicinales et aux remèdes populaires pour combattre les infections. Aujourd’hui encore, de nombreuses plantes et substances naturelles ont des propriétés antimicrobiennes prouvées. Leur efficacité n’est peut-être pas aussi immédiate que celle des médicaments sur ordonnance, mais elles peuvent contribuer à inhiber les bactéries et à renforcer les défenses immunitaires . Dans certains cas, elles peuvent sauver des vies en contrôlant une infection jusqu’à ce que le système immunitaire la maîtrise.
Miel brut :
Les anciens Égyptiens traitaient les plaies avec du miel comme antibiotique naturel, et il est toujours utilisé dans les soins modernes des plaies (pansements au miel de qualité médicale). 1 Le miel a de multiples effets : il contient naturellement de petites quantités de peroxyde d’hydrogène, sa forte teneur en sucre qui extrait l’eau des cellules bactériennes et son acidité – tout cela créant un environnement hostile aux bactéries. 2 Pour utiliser le miel, appliquez-le généreusement sur une plaie nettoyée , puis couvrez-la d’un pansement. Il aidera à tuer les bactéries et à maintenir la plaie humide et protégée pendant sa cicatrisation. 3 (Le miel de Manuka de Nouvelle-Zélande est particulièrement réputé pour sa puissance, mais n’importe quel miel brut et non filtré fait l’affaire.) Vous pouvez également consommer du miel pour soulager un mal de gorge ou une toux : il enrobe et combat les bactéries dans la gorge. Conseil : ne donnez jamais de miel aux nourrissons de moins d’un an (risque de botulisme). Pour tous les autres, le miel est généralement très sûr, à l’exception de son côté sucré pour les diabétiques.
Ail:
Souvent appelé « pénicilline russe », l’ail est un puissant antibiotique naturel. 4 Pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque les réserves de véritables antibiotiques étaient épuisées, les médecins russes utilisaient de l’ail écrasé sur les plaies, ce qui est devenu célèbre – d’où son surnom. 5 L’ail contient de l’allicine , un composé soufré aux puissants effets antibactériens (et antifongiques). Des études scientifiques confirment que les composés de l’ail sont efficaces contre de nombreux types de bactéries, même certaines multirésistantes aux médicaments. 6 Comment l’utiliser ? L’ail cru est le plus puissant : vous pouvez écraser une gousse, la laisser reposer 10 minutes (ce qui permet à l’allicine de se former), puis appliquer la purée juteuse sur un pansement et le placer sur une plaie infectée (recouvrir d’une gaze ; attention, l’ail cru peut irriter la peau, évitez donc de le laisser agir plus d’une heure ou deux à la fois). Pour les infections internes, la consommation d’ail cru ou d’extrait d’ail peut aider de l’intérieur ; il a été utilisé pour tout, des infections de la gorge aux microbes intestinaux. Consommez 1 à 2 gousses d’ail par jour , finement hachées et avalées (vous pouvez les mélanger avec une cuillère de miel ou les tartiner sur un cracker pour un goût plus agréable). Les comprimés ou poudres d’ail sont une option, mais en cas de survie, vous avez probablement les bulbes crus. Attention : l’ail peut fluidifier le sang. Si vous prenez des anticoagulants ou souffrez d’un trouble de la coagulation, utilisez-en des quantités modérées et surveillez l’apparition de tout problème .
Gingembre:
Cette racine de gingembre épicée dans votre garde-manger est bien plus qu’une simple tisane pour calmer l’estomac : c’est aussi un agent antibactérien et anti-inflammatoire. Des études montrent que le gingembre peut inhiber diverses bactéries, notamment les streptocoques et les staphylocoques . 8 Le gingembre est particulièrement efficace contre les infections gastro-intestinales (il est excellent en cas d’intoxication alimentaire ou de diarrhée) et les infections respiratoires. Utilisez-le en préparant une tisane au gingembre corsée (faites mijoter du gingembre frais, tranché ou râpé, dans de l’eau pendant 10 à 15 minutes, puis ajoutez du miel et du citron pour un effet plus prononcé). Sirotez-en tout au long de la journée pour lutter contre une infection de la gorge ou des voies respiratoires. Pour les plaies, le thé au gingembre refroidi peut être utilisé comme bain, bien que ses effets sur les bactéries cutanées soient plus doux que ceux de l’ail ou du miel. Les propriétés anti-inflammatoires du gingembre peuvent néanmoins aider à réduire la douleur et l’enflure d’une zone infectée. 9 Et si la maladie s’accompagne de nausées ou de crampes d’estomac, le gingembre y remédie également.
Échinacée :
Plante réputée pour ses vertus immunostimulantes, l’échinacée était utilisée par les Amérindiens contre les infections bien avant de devenir un complément alimentaire à la mode. Des recherches récentes indiquent que les extraits d’échinacée ont un effet antibactérien, notamment sur les bactéries responsables des infections respiratoires. 1 0 L’échinacée peut également stimuler le système immunitaire pour lutter contre les virus, réduisant potentiellement le recours aux antibiotiques dans des maladies comme la bronchite. En dehors du réseau électrique, la teinture ou les gélules d’échinacée sont utiles dans votre trousse de phytothérapie. Utilisation : Dès les premiers signes d’infection, commencez à prendre de l’échinacée (la dose adulte typique est de 300 mg d’extrait sec ou 2,5 ml de teinture, trois fois par jour). Son efficacité est optimale dès le début : elle peut empêcher un léger rhume de se transformer en une infection des sinus, par exemple. Remarque : si vous êtes allergique à l’ambroisie, utilisez l’échinacée avec prudence (elles appartiennent à la même famille). De plus, l’échinacée est généralement utilisée à court terme (une semaine ou deux) plutôt qu’en continu.
Clou de girofle:
Le clou de girofle est une épice qui a du punch. L’huile essentielle de clou de girofle contient de l’eugénol, un antiseptique et un analgésique (les dentistes l’utilisent pour les maux de dents). Une étude de 2023 a confirmé que l’huile essentielle de clou de girofle a un puissant effet inhibiteur sur le staphylocoque doré (une bactérie courante des plaies et des infections cutanées). 1 1 Si vous souffrez d’infections dentaires ou d’un vilain abcès dentaire et que vous ne prenez pas d’antibiotiques, le clou de girofle est votre meilleur ami. Appliquez une goutte d’huile essentielle de clou de girofle sur un coton et appuyez sur la dent ou la gencive douloureuse ; cela engourdira la douleur et aidera à tuer les bactéries localement. Pour un usage cutané, vous pouvez ajouter quelques gouttes d’huile essentielle de clou de girofle à une huile végétale ou à de l’eau propre et appliquer comme un lavage désinfectant (elle est puissante, ne l’utilisez donc pas pure sur de grandes surfaces de peau). Mâcher quelques clous de girofle séchés peut également soulager un mal de gorge ou assainir la bouche. Fait amusant : le clou de girofle était si efficace historiquement que pendant la peste, les pilleurs de tombes auraient utilisé un vinaigre infusé de clous de girofle (et d’autres herbes) pour se protéger – le célèbre « vinaigre des quatre voleurs ».
Origan (huile d’origan) et thym :
Ces herbes aromatiques possèdent des propriétés antimicrobiennes, principalement grâce à des composés comme le carvacrol et le thymol . L’huile essentielle d’origan est si puissante qu’elle peut même tuer certaines bactéries résistantes aux antibiotiques lors d’études en laboratoire. 1 2 En pratique, l’huile essentielle d’origan (généralement disponible sous forme de compte-gouttes liquide ou de capsules) peut être utilisée pour les infections respiratoires, voire les infections intestinales légères. Attention : elle est très puissante et peut brûler ; suivez donc les instructions de dilution ; il suffit souvent de quelques gouttes dans un verre d’eau ou de jus. De nombreux survivalistes ne jurent que par l’huile essentielle d’origan dès les premiers signes d’une sinusite ou d’une bronchite. Vous pouvez également inhaler la vapeur d’origan ou de thym. Exemple : faites bouillir une casserole d’eau, ajoutez une cuillère à café d’origan ou de thym séché, couvrez et laissez infuser 5 minutes, puis enveloppez-vous d’une serviette et inhalez la vapeur (en veillant à ne pas vous brûler). Cela peut aider à dégager les voies nasales et les sinus grâce à sa vapeur antimicrobienne. La tisane de thym (au miel) est un remède classique contre la toux et la bronchite, soulageant les symptômes et combattant les germes. En fait, un composé chimique présent dans le thym (le thymol) est utilisé dans les bains de bouche médicamenteux modernes. En cas d’infections de la gorge ou de la bouche, gargarisez-vous avec une infusion de thym concentrée ou une goutte d’huile essentielle de thym diluée dans de l’eau tiède.
Vinaigre et aliments fermentés :
Le vinaigre de cidre possède des propriétés antibactériennes modestes grâce à son acidité. Moins puissant que les autres produits mentionnés ci-dessus, il peut néanmoins être efficace comme solution nettoyante pour les surfaces, voire la peau. Un remède traditionnel contre les maux de gorge consiste à se gargariser avec du vinaigre (dilué avec de l’eau) ou du vinaigre additionné de sel : cela crée un environnement acide que les microbes détestent. Le vinaigre était un ingrédient clé de nombreux toniques désinfectants anciens (comme les Quatre Voleurs mentionnés). De plus, les aliments fermentés comme la choucroute, le yaourt et le kombucha contiennent des bactéries et des acides bénéfiques qui peuvent éliminer les microbes nocifs dans l’intestin. À long terme, la fermentation des légumes permet non seulement de conserver les aliments, mais aussi d’obtenir des probiotiques qui protègent contre les infections intestinales.
Argent colloïdal (à utiliser avec précaution) :
Certains survivalistes utilisent l’argent colloïdal comme « antibiotique alternatif ». L’argent a des effets antimicrobiens : les hôpitaux utilisent des pansements enduits d’argent pour les brûlures et les plaies chroniques, car il tue les bactéries. Cependant, l’ingestion d’argent colloïdal peut être risquée et son efficacité à l’intérieur de l’organisme n’est pas bien prouvée. 1 3 Si vous disposez d’une solution d’argent colloïdal, il peut être utile de l’appliquer localement sur une plaie pour réduire le nombre de bactéries (imaginez-la comme un pansement liquide). Mais n’abusez pas de l’argent en espérant guérir une infection : une utilisation prolongée peut donner à votre peau une teinte bleu-gris permanente (une affection appelée argyrie) et entraîner d’autres problèmes. 1 4 Certains organismes médicaux mettent en garde contre le manque de preuves de l’efficacité de l’argent colloïdal et son potentiel plus néfaste que bénéfique. 1 5 Ne l’utilisez qu’en solution de secours, et si possible en usage externe. En revanche, l’utilisation de gaze imprégnée d’argent sur une plaie, si vous en avez dans votre trousse, est une excellente stratégie pour prévenir l’infection.
Autres éléments à prendre en compte :
Le curcuma (curcumine) est anti-inflammatoire et légèrement antibactérien. Une pâte de curcuma diluée dans de l’eau propre peut être appliquée sur les infections cutanées (il était traditionnellement utilisé sur les plaies en Inde). L’achillée millefeuille est une plante sauvage dont les feuilles et les fleurs peuvent être écrasées en cataplasme ; elle favorise la coagulation du sang et possède des propriétés antiseptiques, utiles pour les plaies. La feuille de plantain (la mauvaise herbe commune des pelouses) peut également être mâchée en cataplasme pour réduire l’infection et l’inflammation des morsures ou des petites coupures ; c’est ce qu’on appelle le « pansement de la nature ». L’hydraste du Canada est une plante contenant de la berbérine, efficace contre certaines bactéries ; sa teinture peut être utilisée sur les plaies ou en cas de diarrhée. Si vous vous intéressez aux plantes médicinales sauvages, privilégiez celles que l’on trouve couramment dans votre région et qui ont une réputation antimicrobienne ou cicatrisante. Consultez toujours plusieurs sources avant d’utiliser une plante sauvage à des fins médicinales, afin de garantir son identification et sa sécurité.
Les remèdes naturels sont-ils vraiment efficaces ? Il est sage d’être raisonnablement sceptique : non, appliquer de l’ail sur une gangrène sévère ne la guérira pas comme par magie, contrairement à la pénicilline par voie intraveineuse. Mais des études confirment que nombre de ces remèdes ont de réels effets antibactériens. 1 6 Ils peuvent ralentir une infection ou la maintenir localisée, laissant ainsi le temps à votre système immunitaire de terminer son travail. Dans certains cas (infections légères à modérées), une combinaison de ces méthodes peut même vaincre complètement la maladie. L’essentiel est de les appliquer tôt et régulièrement . En l’absence de médicaments en pharmacie, on utilise tout ce qui est possible pour lutter contre les microbes : plusieurs plantes, topiques et internes, ainsi qu’une bonne alimentation et du repos.
Enfin, n’oubliez pas le pouvoir de la chaleur et du soleil . En cas d’infection cutanée, des compresses chaudes peuvent stimuler la circulation sanguine et favoriser l’accès des cellules immunitaires (veillez simplement à ne pas emprisonner de pus ; si un abcès se forme, il faudra peut-être le drainer, ce que nous verrons plus loin). La lumière du soleil émet des rayons UV qui peuvent tuer les bactéries sur les surfaces ; exposer la literie ou les vêtements au soleil peut les assainir dans une certaine mesure.
La nature possède une panoplie d’outils. En connaissant un peu la phytothérapie , vous enrichirez votre stratégie de survie lorsque la pharmacie fermera définitivement.
Antiseptiques à l’ancienne et traitements maison
Les antibiotiques modernes n’existent que depuis les années 1940. Comment traitait-on les infections avant cette date ? Comprendre les méthodes antiseptiques traditionnelles nous offre des options supplémentaires lorsque les médicaments viennent à manquer. Voici quelques remèdes historiques éprouvés et des traitements maison que vous pouvez utiliser hors réseau :
Solution de Dakin (eau de Javel diluée) :
Pendant la Première Guerre mondiale, avant l’apparition des antibiotiques, les médecins avaient désespérément besoin d’un remède pour soigner les blessures de guerre infectées. Un chimiste nommé Henry Dakin a mis au point une solution d’ hypochlorite de sodium (essentiellement de l’eau de Javel) et d’acide borique – un antiseptique doux qui pouvait nettoyer les plaies sans endommager les tissus. 17 Cette « solution Dakin » a changé la donne, rendant apparemment l’infection presque impossible lorsqu’elle était utilisée correctement sur les plaies. 18 Vous pouvez préparer une solution similaire à la maison : prenez de l’eau de Javel (non parfumée, eau de Javel ordinaire) et diluez 1 volume d’ eau de Javel dans environ 100 volumes d’eau propre (soit environ 2 cuillères à soupe d’eau de Javel pour 4 litres d’eau) – plus une pincée de bicarbonate de soude (acide borique si vous en avez) pour tamponner la solution. Utilisez-la pour irriguer les plaies sales et profondes après le nettoyage initial. Elle tue de nombreuses bactéries au contact. Important : N’utilisez PAS d’eau de Javel pure sur la peau ! Cela provoquerait des brûlures chimiques. Mais correctement dilué (0,5 % ou moins de chlore actif), c’est un antiseptique puissant qui a sauvé de nombreuses vies à l’époque pré-antibiotique. 1 9 Ne préparez que la quantité nécessaire pour une utilisation unique – la solution perd de son efficacité avec le temps, et veillez à la garder hors des yeux et uniquement dans la zone de la plaie.
Alcool et iode :
Votre trousse de premiers secours contient probablement des lingettes alcoolisées ou une petite bouteille d’iode (bétadine). Ce sont des antiseptiques de première intention pour prévenir l’infection des petites coupures. Hors réseau, vous pourriez éventuellement manquer de tampons de préparation commerciaux, mais vous pouvez improviser. Alcool : Les alcools forts (whisky, vodka, etc., au moins 40 % d’alcool) peuvent désinfecter en un clin d’œil. Moins efficaces que l’alcool isopropylique, mais plus efficaces que l’eau seule pour nettoyer une plaie. Teinture d’iode : Si vous avez des comprimés d’iode pour purifier l’eau, en dissolvant quelques-uns dans une tasse d’eau propre, vous obtiendrez un produit désinfectant pour les plaies (il sera brun et peut tacher, mais il tue les germes). Utilisez ces produits chimiques uniquement en usage externe. Ils contribuent à réduire le nombre de bactéries au niveau de la plaie, donnant à votre corps une chance de se défendre.
Stérilisation par ébullition et flamme :
Si vous devez effectuer une intervention mineure (percer un furoncle, retirer une écharde profondément incrustée, etc.), assurez-vous que vos outils sont stériles. Faites bouillir les instruments métalliques pendant au moins 5 minutes ou chauffez-les au feu jusqu’à ce qu’ils soient incandescents (puis laissez refroidir). Pour les bandages ou les tissus, faites-les bouillir ou cuire sous pression si vous en avez la possibilité, et utilisez-les propres, directement dans la casserole. En situation de survie, le feu est votre stérilisateur : utilisez une flamme nue pour stériliser les lames de couteau ou les aiguilles (là encore, laissez refroidir avant utilisation). Ce n’est pas parfait à 100 %, mais cela réduit considérablement les agents pathogènes.
Thérapie par les asticots (dernier recours mais efficace) :
Cette méthode n’est pas pour les âmes sensibles, mais elle a fait ses preuves . Certaines larves de mouches (asticots) ne mangent que les tissus morts et produisent des antibiotiques naturels en se nourrissant. Dans les hôpitaux de campagne crasseux de la guerre de Sécession, les médecins ont remarqué que les plaies infestées d’asticots étaient souvent mieux traitées : les asticots nettoyaient la pourriture qui aurait tué le patient. Un chirurgien confédéré, le Dr J.F. Zacharias, a rapporté que « en une seule journée, les asticots nettoyaient une plaie bien mieux que tous les agents dont nous disposions… Je suis sûr d’avoir sauvé de nombreuses vies grâce à leur utilisation. » 2 0 Aujourd’hui, la thérapie par asticots stériles est un traitement reconnu pour les plaies qui ne cicatrisent pas. Dans un scénario de survie, si quelqu’un a une plaie gangrénée ou des tissus nécrosés et que vous n’avez ni antibiotiques ni installations chirurgicales, laisser des larves de mouches propres faire leur travail pourrait lui sauver la vie. Comment feriez-vous cela ? Idéalement, il faudrait laisser les mouches pondre leurs œufs sur une plaie très sale et pleine de tissus morts (les mouches sont attirées par les tissus morts). Ensuite, il faudrait la recouvrir légèrement pour retenir les larves. Les asticots éclosent et dévorent la chair morte et les bactéries, nettoyant ainsi une plaie autrement désespérée. Après un jour ou deux, rincez-les abondamment à l’eau stérile dès que la plaie paraît plus propre (il ne faut pas qu’ils commencent à manger de la chair saine). C’est vraiment une mesure de dernier recours , mais il est bon de savoir que, aussi grotesque que cela puisse paraître, la nature a même fourni une sorte de « chirurgien de campagne » sous la forme d’asticots. Bien des colons ou soldats piégés avant l’arrivée des antibiotiques ont survécu à d’horribles blessures grâce à ces médecins frétillants.
Chaleur et drainage pour les abcès :
Un abcès douloureux (poche de pus localisée) est le moyen utilisé par l’organisme pour contenir une infection. Sans antibiotiques, l’une des meilleures façons de traiter un abcès (par exemple, un furoncle ou une plaie infectée) est de favoriser son ouverture et son drainage . Appliquez des compresses chaudes sur la zone plusieurs fois par jour (un linge propre imbibé d’eau chaude, aussi chaude que possible, pendant 10 à 15 minutes). La chaleur stimule la circulation et peut aggraver l’abcès. Dès qu’une petite zone molle ou un « point blanc » de pus apparaît, vous devrez peut-être le percer : stérilisez un couteau ou une aiguille pointue et piquez/coupez délicatement l’abcès pour laisser le pus s’écouler.
Attention : Ne procédez ainsi que pour les abcès superficiels (comme les furoncles). Pour tout abcès profond ou facial (comme un abcès dentaire), soyez très prudent : les infections faciales peuvent être dangereuses si elles se propagent vers l’intérieur. Après le drainage, rincez à l’eau salée bouillie ou à l’iode diluée, puis tamponnez légèrement avec un morceau de tissu ou de gaze propre pour permettre le drainage. Retirer cette accumulation de pus peut soulager considérablement la douleur et éliminer une grande quantité de bactéries du corps. Veillez toutefois à toujours rester propre : lavez-vous les mains et tout le matériel, portez des gants si possible et évitez d’enfoncer les bactéries plus profondément. La chaleur et le drainage ne remplaceront pas les antibiotiques si l’infection s’est propagée, mais ils peuvent transformer une infection localisée grave en plaie cicatrisante.
Cataplasmes et pâtes topiques :
De nombreux remèdes traditionnels consistent à préparer un cataplasme (une mixture humide de plantes ou de substances) à appliquer sur la zone infectée. Nous avons déjà mentionné l’ail et le miel, qui peuvent d’ailleurs être combinés (une pâte d’ail et de miel appliquée sur une plaie est doublement antibactérienne).
Autres cataplasmes utiles : Cataplasme d’oignon : faites cuire ou bouillir un oignon jusqu’à ce qu’il soit tendre, écrasez-le et appliquez-le chaud sur une infection cutanée (l’oignon, comme l’ail, contient des composés soufrés antimicrobiens, bien que plus doux). Cataplasme de pain et de lait : un vieux remède maison contre les furoncles : trempez du pain dans du lait chaud, appliquez-le en bouillie tiède sur le furoncle ; en refroidissant, il peut aider à « extraire » l’infection (cela peut ramollir la peau au-dessus du furoncle et favoriser son éruption). Pâte d’argile ou de charbon : si vous avez accès à du charbon actif (provenant d’une trousse de premiers soins ou fabriqué à partir de bois carbonisé et purifié), le mélanger à un peu d’eau pour obtenir une pâte peut aider à éliminer les toxines et même les bactéries d’une plaie. Étalez une couche épaisse de pâte de charbon, couvrez d’un linge et changez-la toutes les quelques heures. De même, certaines argiles (comme l’argile bentonite) mélangées à de l’eau peuvent absorber les toxines bactériennes et assécher une zone infectée. Elles ne tuent pas les microbes directement, mais elles réduisent la charge bactérienne et l’inflammation, favorisant ainsi la cicatrisation.
N’oubliez pas que ces méthodes traditionnelles demandent beaucoup de travail ; il faut persévérer : irriguer les plaies plusieurs fois par jour, changer les pansements au miel quotidiennement (ils deviennent gluants), appliquer des cataplasmes frais et chauds, etc. C’est loin d’être la même chose que de prendre un comprimé deux fois par jour. Mais vos efforts et votre vigilance sont la clé de voûte de la médecine moderne. Combinées, nombre de ces méthodes peuvent avoir un effet comparable à celui des antibiotiques en limitant la croissance bactérienne et en prévenant la propagation de l’infection.
Traitement d’urgence des infections étape par étape (sans antibiotiques)
Mettons tout en place. Si vous êtes confronté à une infection grave hors réseau et que vous n’avez pas d’antibiotiques à disposition , voici un plan d’action pour gérer le problème au mieux :
1. Identifier l’infection :
Tout d’abord, déterminez à quoi vous avez affaire. S’agit-il d’une infection externe (rougeur, pus, gonflement sur une coupure ou une blessure) ? D’une infection interne comme une pneumonie (toux, fièvre, difficultés respiratoires) ou d’une infection intestinale (diarrhée sévère, déshydratation) ? Identifier le type d’infection probable oriente votre approche. Par exemple, un abcès à la jambe ou une fièvre sans plaie visible peuvent nécessiter des stratégies différentes. Prenez les signes vitaux de la personne si possible (température, pouls) : une forte fièvre, un rythme cardiaque rapide ou un manque d’énergie sont des signes avant-coureurs d’une infection grave.
2. Nettoyer et égoutter (le cas échéant) :
En cas de plaie, d’abcès ou d’infection localisée, commencez par nettoyer . Ne soyez pas trop doux avec les germes ; nettoyez minutieusement, mais ménagez les tissus pour éviter d’aggraver les lésions. Utilisez une solution d’eau bouillie et de sel (solution saline) ou une solution diluée d’iode/eau de Javel pour rincer les plaies. Retirez les débris. Si un abcès est présent et que vous êtes formé/capable, incisez et drainez le pus (comme décrit ci-dessus). L’élimination du pus et des tissus nécrosés élimine physiquement une grande quantité de bactéries. Désinfectez toujours vos outils et portez des gants ou lavez-vous soigneusement les mains. En cas d’infection interne (pas de plaie à nettoyer), concentrez-vous d’abord sur le contrôle des symptômes. Par exemple, si une personne a une forte fièvre, hydratez-la et rafraîchissez-la légèrement, car une forte fièvre peut être dangereuse.
3. Attaquez avec des antibiotiques naturels :
Maintenant, place aux remèdes naturels . Pour les infections de plaies , après le nettoyage, appliquez du miel ou des antibactériens à base de plantes : enduisez la plaie d’une couche de miel cru ou de sucre (le sucre est aussi un remède ancien : il absorbe l’humidité des bactéries). Vous pouvez aussi appliquer un cataplasme ail-miel ou saupoudrer de poudre de racine d’hydraste du Canada écrasée si vous en avez (l’hydraste du Canada est un antiseptique naturel). Couvrez la zone d’un pansement propre. Réappliquez du miel frais et des pansements au moins une ou deux fois par jour.
Pour les infections respiratoires , commencez un traitement à base d’ail, d’origan et de tisanes : faites boire au patient un bouillon d’ail (ail écrasé trempé dans de l’eau chaude avec du miel et un peu de piment de Cayenne), une tisane au gingembre et une tisane au thym et au miel. Pratiquez l’inhalation de vapeur avec du thym ou de l’origan. Envisagez de prendre quelques gouttes d’huile essentielle d’origan sous la langue ou dans du jus quotidiennement (si possible). Donnez-lui des stimulants immunitaires comme de l’échinacée, voire de la vitamine C à forte dose, si vous en avez.
En cas d’infection intestinale , privilégiez l’hydratation (eau purifiée avec une pincée de sel et de sucre – une solution de réhydratation orale maison). Administrez du charbon en cas de diarrhée sévère (le charbon peut lier les toxines et réduire la déshydratation). Proposez une tisane à la menthe ou à la camomille pour apaiser et éventuellement agir comme antimicrobiens légers dans l’intestin. Évitez les antidiarrhéiques comme le lopéramide en cas de dysenterie : il faut éliminer les toxines, il suffit de gérer les fluides. Privilégiez les probiotiques issus d’aliments fermentés (même un peu de yaourt fermenté si vous avez un moyen de le conserver, ou des légumes fermentés) pour lutter contre les mauvaises bactéries intestinales.
4. Soutenir le corps :
L’infection est un combat ; il est essentiel de soutenir le corps du patient dans ce combat. Cela implique du repos (un alitement strict si possible en cas d’infection grave ; même un simple mouvement peut propager une infection localisée dans le sang). Gardez-le au chaud (ou au frais si la fièvre est dangereusement élevée, supérieure à environ 40 °C ; des bains tièdes à l’éponge peuvent ensuite la faire baisser progressivement). Assurez-vous qu’il boive beaucoup de liquide ; la fièvre et l’infection déshydratent. S’il peut manger, donnez-lui des aliments nutritifs et faciles à digérer (bouillons, si disponibles, ou céréales simples).
En cas de fièvre , outre les médicaments, vous pouvez utiliser des antipyrétiques naturels : la tisane d’écorce de saule (si vous savez reconnaître les saules, son écorce contient de la salicine, similaire à l’aspirine) ou la reine des prés peuvent soulager la douleur et la fièvre. Mais ne faites pas baisser la température d’une fièvre modérée : la fièvre est une réaction bactérienne provoquée par l’organisme. N’essayez de refroidir que si la température est extrêmement élevée ou si la personne est très mal à l’aise. Utilisez des lingettes humides et froides sur le front, les aisselles ou l’aine pour faire baisser la température en toute sécurité.
5. Surveiller de près et s’adapter :
Dans un monde sans pilule universelle, il est essentiel de faire preuve de diligence et de flexibilité . Vérifiez le site de l’infection ou les symptômes du patient plusieurs fois par jour . La plaie est-elle plus rouge ou présente-t-elle des stries rouges ? (Des stries rouges peuvent indiquer une infection en progression ; il est temps d’intensifier les mesures, et s’il reste des antibiotiques, c’est à ce moment-là qu’il faut les utiliser.) La fièvre s’améliore-t-elle après deux jours ou est-elle toujours forte ? Si la situation s’aggrave malgré le traitement, il faudra peut-être essayer autre chose. Par exemple, si l’ail et le miel sur une plaie n’arrêtent pas la propagation, vous pouvez envisager une irrigation avec la solution de Dakin et une exposition à l’air libre. Ou si une tisane ne soulage pas la toux, ajoutez une autre plante ou une approche différente (comme un pansement à la moutarde sur la poitrine, un traitement traditionnel pour stimuler la circulation sanguine). Isolement : Tenez la personne malade à l’écart des autres pour éviter la contagion, en particulier en cas de grippe ou de tuberculose. Portez un tissu sur votre visage (ou un masque approprié si vous en avez un) lorsque vous vous en occupez pour vous protéger – vous ne pouvez aider personne si vous tombez malade vous aussi.
6. Sachez quand improviser ou évacuer :
Si, malgré tous vos efforts, l’infection est manifestement insurmontable – par exemple, si votre patient est pris de délire et de fièvre, ou si une plaie infectée se transforme en gangrène – vous devez prendre une décision difficile. S’il existe un moyen d’obtenir de l’aide extérieure (aller à pied jusqu’à une route, appeler à l’aide par radio, utiliser la dose d’antibiotiques que vous avez mise de côté), faites-le au plus vite . Il se peut que vous ne disposiez que d’un court laps de temps avant qu’une infection ne dégénère en septicémie (infection du sang), souvent mortelle sans soins hospitaliers. En l’absence de secours (véritable isolement hors réseau), vous avez encore des options pour improviser : par exemple, amputer un membre si une infection du pied se propage et est fatale – au XIXe siècle, on le faisait sur la table de cuisine et certains survivaient. C’est extrême et dangereux, mais ne rien faire si la mort est certaine l’est tout autant. Ou peut-être vous souvenez-vous d’une vieille réserve d’antibiotiques enfouie quelque part ? C’est le moment de l’utiliser. Essayez toujours d’épuiser toutes les options. Parfois, une combinaison de petites mesures s’additionne : une petite amélioration grâce à l’herbe A + une certaine amélioration grâce au remède B + les efforts du corps peuvent collectivement renverser la situation.
7. Poursuivre le traitement après une guérison évidente :
Une erreur consiste à arrêter les soins trop tôt. Si une plaie commence à s’améliorer, n’arrêtez pas brusquement de la nettoyer quotidiennement ou d’appliquer du miel. Poursuivez votre traitement pendant plusieurs jours, même après l’amélioration des symptômes , afin de garantir la guérison complète de l’infection et d’éviter toute récidive. C’est un peu comme terminer un traitement antibiotique. Avec les plantes et les soins topiques, la durée du traitement est plus difficile à déterminer ; privilégiez donc un traitement plus long. Diminuez progressivement la dose lorsque vous êtes certain que l’infection a disparu.
Pendant tout ce temps, prenez des notes si possible. Notez la température matin et soir, l’aspect de la plaie, ce que vous avez appliqué, etc. Cela vous aidera à identifier des schémas (par exemple, des pics de fièvre nocturnes, ou un cataplasme qui a fait sortir beaucoup de pus). Ces informations seront également utiles pour les incidents futurs.
Conclusion : La connaissance est le meilleur remède (partagez-la et préparez-vous)
Confronter un monde sans antibiotiques est un défi de taille, mais comme nous l’avons vu, la situation est loin d’être désespérée . En vous préparant à l’avance – en stockant les médicaments essentiels et en apprenant les remèdes traditionnels – vous vous donnez les moyens de gérer des infections qui seraient autrement mortelles. Nous avons expliqué que la prévention est la meilleure stratégie, comment conserver et utiliser en toute sécurité les antibiotiques disponibles, et comment recourir aux plantes médicinales et aux remèdes traditionnels lorsque c’est nécessaire. Nous avons même abordé des solutions plus concrètes comme la thérapie par les asticots et l’eau de Javel, que nos ancêtres utilisaient pour survivre.
Le point à retenir est le suivant : lorsque les antibiotiques viennent à manquer, la connaissance et l’ingéniosité prennent le relais . Vous disposez désormais d’une panoplie de méthodes – du miel cru sur une plaie à la soupe à l’ail pour un patient fiévreux – qui peuvent faire la différence entre la guérison et la tragédie. Non, ce n’est pas aussi simple que de prendre un comprimé. Cela demande des efforts, de l’ingéniosité et la volonté de se battre. Mais les humains ont survécu aux épidémies et aux infections pendant des millénaires grâce à ce type de méthodes. Vous pouvez le faire aussi.
Récapitulatif des points clés
Gardez vos plaies propres et couvertes. Si possible, stockez et conservez une petite quantité d’antibiotiques à large spectre. Utilisez des antibiotiques naturels comme l’ail, le miel et l’huile d’origan pour ralentir les infections. Utilisez des antiseptiques, la chaleur, le drainage et même des insectes utiles pour soigner les plaies graves. Et surtout, maintenez une bonne hygiène et une santé robuste pour prévenir autant que possible les infections.
En cas de véritable panne de courant ou de survie hors réseau, chaque famille et chaque groupe devrait avoir un plan de secours . Commencez à constituer votre trousse de premiers soins à base de plantes et pratiquez dès maintenant certains de ces remèdes (par exemple, essayez de préparer un sirop ail-miel pour votre prochain gros rhume, afin de vérifier son efficacité). Plus vous intégrerez ces connaissances à votre vie, mieux vous serez préparé si la pharmacie n’est plus une option.
Lorsque les antibiotiques viennent à manquer, votre volonté de vivre et vos connaissances pour agir deviennent de véritables bouées de sauvetage. Tirez parti de ces informations, complétez-les par vos propres recherches (apprenez sans cesse !) et préparez-vous. Votre vie – ou celle de quelqu’un d’autre – pourrait un jour dépendre des compétences et des remèdes que vous avez appris.
Transmettez ces connaissances – partagez ces conseils avec vos amis ou vos collègues survivalistes. Au final, la sagesse collective est aussi cruciale que ce dernier flacon de pénicilline. Ensemble, nous pouvons survivre et prendre soin les uns des autres, même dans un monde où la médecine est difficile.
Clause de non-responsabilité
Cet article est fourni à titre éducatif uniquement et ne remplace pas une consultation médicale . Traiter les infections sans surveillance médicale comporte de graves risques. Certaines plantes peuvent provoquer des réactions allergiques ou interagir avec des médicaments , et une mauvaise utilisation d’antiseptiques ou de remèdes alternatifs peut être nocive. Confirmez toujours l’identification de la plante et consultez un professionnel de santé qualifié dès que possible , surtout si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous souffrez d’une maladie chronique ou si vous êtes allergique aux antibiotiques. N’utilisez ces méthodes qu’en dernier recours, en cas d’urgence réelle , et non en remplacement d’un traitement médical approprié lorsqu’il est disponible.
Source:https://eraoflight.com/2025/08/11/key-natural-antibiotic-remedies-to-know/
Traduit et partagé par les Chroniques d'Arcturius
- POSER UN GESTE D'AMOUR -
Une contribution volontaire
aide véritablement à maintenir ce site ouvert
et ainsi vous devenez un Gardien Passeurs en action.
CLIQUEZ ICI POUR CONTRIBUER
Merci
Texte partagé par Les Chroniques d'Arcturius - Au service de la Nouvelle Terre